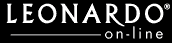Les théories de Pierre Schaeffer
Les erreurs et le chercheur
En 1948, Pierre Schaeffer réalise par hasard les expériences du sillon fermé et de la cloche coupée. Mais le plus intéressant est de comprendre que la naissance de la musique concrète n'est pas contenue dans ces deux expériences mais dans l'interrogation qu'elles ont suscités chez le chercheur :
1) le sillon fermé : en bouclant un son sur lui-même Pierre Schaeffer isole le son de ce qui était avant lui et de ce qui le suivra. Il devient un objet décontextualisé et utilisable avec d'autres sons prélevés dans des contextes totalement différents ;
2) la cloche coupée : en enlevant, par inadvertance, l'attaque d'un son de cloche lors de son enregistrement, Pierre Schaeffer réalise que son savoir sur les lois de l'acoustique issues de ses maîtres s'écroule. En effet ce son de cloche devient, sans son attaque, un son de hautbois ! Manifestement, le timbre n'est pas seulement déterminé par l'étagement des harmoniques sur une fondamentale.
Pierre Schaeffer a eu le génie de réfléchir à ce que ces erreurs pouvaient avoir comme conséquences sur sa conception du monde sonore. Il est probablement impossible que d'autres n'est pas déjà fait ces deux expériences. Pourtant il fut le seul a décider de s'investir dans deux aventures intimement liées : la musique concrète et une nouvelle orientation pour la recherche musicale. Le milieu musical des années 1950 était était alors dominé par la musique néo-sérielle.
La musique concrète
Le 15 mai 1948, Pierre Schaeffer décide de nommer ce nouvel art sonore qu'il expérimente : musique concrète. Le terme de concret s'oppose à celui d'abstrait détenu par les compositeurs de musique instrumentale. En effet, tandis que les compositeurs instrumentaux partent d'une idée abstraite (concept) pour la réaliser concrètement ("sonorement"), les compositeurs concrets partent eux du concret sonore (les sons) pour élaborer une structure musicale (abstraite). Le schéma est donc inversé. Le préalable est d'un côté, abstrait, et de l'autre, concret.
Musique concrète désigne donc une démarche compositionnelle et en aucun cas (du moins au début) une volonté de n'utiliser que les sons enregistrés que l'on appelle souvent son concret, l'électronique aura aussi sa place dans le Studio d'Essai.
La recherche musicale 1 : La perception et l'écoute réduite
Pour Pierre Schaeffer, la découverte d'un nouveau mode de création sonore ne peut être détachée d'une ré-évaluation du phénomène perceptif. Il réfléchira dès 1948 à une redéfinition de la notion d'écoute en fonction des expériences musicales qui l'amèneront à composer les premières œuvres de musique concrète (Le premier journal de la musique concrète le montre clairement). Pourtant les aléas de sa carrière d'administrateur le conduiront à ne véritablement commencer la recherche musicale au sein G.R.M. (Groupe de recherche Musicale) qu'à partir de 1958.
Afin d'étudier ces nouveaux phénomènes sonores, il convient de les isoler et de tenter de les décrire de la façon la plus objective possible. L'isolement des sons, les compositeurs du studio savent le faire : les tournes disques, puis les magnétophones permettent de le réaliser facilement. La description objective, Edmund Husserl la propose avec la réduction phénoménologique. Pierre Schaeffer s'inspire fortement des recherches d'Husserl pour mettre entre parenthèses son savoir sur tel son afin de découvrir, dans sa perception, ce qui ne relève pas de son interprétation ou de son imagination. Ainsi, née l'écoute réduite qui se concentre sur les qualités internes du son. Le son n'est plus un objet interprété, il devient un objet externe qui possède sa propre réalité spatio-temporelle. Il est présent, il est là, en dehors de nous ; à nous de savoir le percevoir comme tel. Toutefois, ceci ne veut pas dire qu'il faut abandonner les autres façons d'écouter. En fait Pierre Schaeffer défini l'attitude perceptive en 4 écoutes :
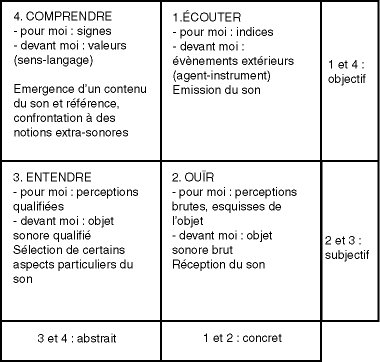
Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, p. 116
Ecouter c'est rechercher dans les indices du son sa provenance possible (la causalité) ; ouïr c'est écouter le son sans se poser de question ; entendre c'est pratiquer l'écoute réduite ; comprendre c'est percevoir la signification des sons (langage ou musique). Ces 4 écoutes sont présentent chez le chercheur mais celui-ci laisse une ou plusieurs attitudes prédominer les autres.
La recherche musicale 2 : L'objet sonore et son solfège
L'objet d'observation de l'écoute réduite n'est plus le son tel qu'on le connaissait auparavant, il convient donc de l'en différencier. Pierre Schaeffer le nommera objet sonore. Ce dernier deviendra le centre de la recherche musicale et de la constitution d'un solfège de l'objet sonore. Le chercheur commence par classer les objets sonores principalement en fonction de leur spectre et de leur évolution temporelle dans une typologie. Puis il analyse plus en profondeur l'objet sonore en le décrivant : Pierre Schaeffer donne, dans le Traité des objets musicaux, 7 critères de valeurs :
1) la masse : organisation du son dans la dimension spectrale ;
2) la dynamique : description de l'intensité des différentes composantes du son ;
3) le timbre harmonique : qualités particulières et "couleur" du son ;
4) le profil mélodique : évolution temporelle du spectre global du son ;
5) le profil de masse : évolution temporelle des composantes spectrales internes du son ;
6) le grain : analyse des irrégularités de surface du son ;
7) l'allure : analyse des vibratos (de hauteur et de dynamique) du son.
Ces critères contiennent chacun un certain nombre d'éléments répartis en types, classes, genres et espèces et formant une cinquantaines de points de description morphologique.
Une théorie sur la communication des mass média
Pierre Schaeffer commence à réfléchir sur les nouvelles relations entre les acteurs des nouveaux médias dès les années 1960. Il publie en 1970 le premier tome d'une série de trois ouvrages : Les machines à communiquer.
Il montre que la simplification des relations humaines dans les mass média ne peut plus être cantonnée à une relation entre l'émetteur et le récepteur. Il résume ses positions dans le triangle de la communication :
La relation entre l'auteur et le public passe désormais par un intermédiaire : le producteur. Celui-ci joue le rôle de médiateur et est en relation avec, d'une part le groupe de programmation et d'autre part, le pouvoir politique (les milieux autorisés). Ce triangle se double donc d'un second triangle inversé révélant les relations complexes entre les 5 groupes de protagonistes :
Ce carré peut-être découpé en 4 petits triangles (les 4 zones) mais aussi en 2 grands triangles (milieu autorisé-public-auteur d'une part et milieu du programmateur-auteur-public d'autre part) ou en deux carrés révélant les milieux de la compétence et de pouvoir. Il ne faut pas négliger non plus les deux diagonales (milieu autorisé-médiateur-public et milieu du programmateur-médiateur-auteur) orientant des aller retour entre le pouvoir et le public et entre la programmation et l'auteur.
Le développement fulgurant de la radio et de la télévision depuis les années 1960 pousse Pierre Schaeffer à énoncer une équation qui ne cessera de se révéler exacte :
création x diffusion = constante
ou la multiplication des radios et des chaînes de télévision entraîne inévitablement un nivellement de la production. La baisse constante de qualité des émissions de radio et de télévision sont particulièrement révélatices des enjeux économiques et politiques qui gouvernent la production. Pierre Schaeffer n'a eu de cesse de les dénoncer, a-t-il seulement été entendu ?
L'ingénieur au service de la musique
Pierre Schaeffer, dans le Studio d'Essai puis les studios du G.R.M.C. et du G.R.M., saura s'entourer d'habiles techniciens. Il suscitera la réalisation de diverses machines :
1) les phonogènes (à coulisse, à clavier et universel) : magnétophones à variateur de vitesse conçus et réalisés avec Jacques Poullin en 1951. Le phonogène à clavier permet une transposition chromatique du son, le phonogène à coulisse une transposition linéaire (glissando) et le phonogène universel réalise des transposition sans changer la durée du son ;
2) le morphophone : système d'écho réalisé avec une bande lue par douze têtes de lecture. Réalisé dans les années 60 par Abraham Moles et Jacques Poullin ;
3) le portique potentiométrique de relief (1951) conçu par Jacques Poullin et permettant de redistribuer lors du concert les différentes masses sonores sur quatre haut-parleurs ;
4) la console du studio 54 conçue et réalisée par Henri Chiarucci et Francis Coupigny et opérationnelle en 1970. Elle est constituée d'une vingtaine de modules de génération et de manipulation électronique entièrement interconnectables entre eux (générateurs de son, filtres, modulateurs de forme, modulateur en anneaux, détecteur d'enveloppe, etc.).
© Pierre Couprie & OLATS, octobre 2000
Nos rubriques :
|