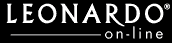Histoire
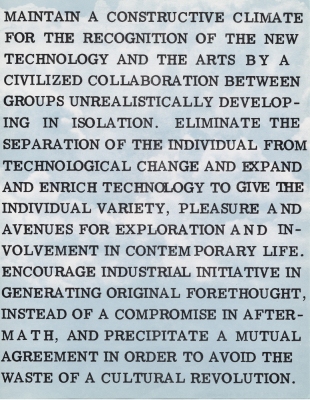 |
Enoncé de mission de Experiments in Arts and Technology, 10 octobre 1966. Gracieuseté de E.A.T. avec la collaboration de la Fondation Daniel Langlois. |
" Maintain a constructive climate for the recognition of the new technology and the arts by a civilized collaboration between groups unrealistically developping in isolation. Eliminate the separation of the individual from technological change and expand and enrich technology to give the individual variety, pleasure and avenues for exploration and involvement in contemporary life. Encourage industrial initiative in generating original forethought, instead of a compromise in aftermath, and precipitate a mutual agreement in order to avoid the waste of a cultural revolution. " 1 |
|
" Entretenir un climat constructif dans le but de susciter la reconnaissance d'une collaboration civilisée entre les nouvelles technologies et les arts pour des communautés qui évoluent trop souvent isolément. Éliminer le fossé qui existe entre l'individu et les changements technologiques ainsi que développer et enrichir la technologie pour offrir la diversité, le plaisir et des avenues afin de favoriser l'exploration et la participation de l'individu dans la vie contemporaine. Encourager les initiatives provenant du milieu industriel en générant des idées visionnaires, au lieu de compromissions après le fait, et activer une entente mutuelle pour ne pas passer à côté d'une révolution culturelle. " (traduction libre, Sylvie Lacerte) |
La fondation d'E.A.T.
C’est dans la foulée du vent d’enthousiasme suscité par les performances 9 Evenings : Theatre and Engineering, tenues, en octobre 1966, au 69th Regiment Armoury devant plus de dix mille personnes, que naquit Experiments in Art and Technology en novembre 1966 à New York. Malgré les critiques tempérées de ces performances, les protagonistes de 9 Evenings réalisèrent que le besoin de prodiguer aux artistes les moyens technologiques soutenant la production de leurs projets, réclamait la création d’un organisme de services permettant de tisser des liens entre l’art et l’industrie.
Billy Klüver 2 et son collègue Fred Waldhauer, tous deux ingénieurs chez Bell Telephone Laboratories, ainsi que les artistes Robert Rauschenberg 3 et Robert Whitman tinrent l’assemblée de fondation de E.A.T., organisme sans but lucratif, le 30 novembre 1966 devant 300 personnes (surtout des artistes). Lors de cette assemblée un questionnaire sur les besoins techniques et technologiques fut remis aux artistes présents. La première rencontre " organisationnelle " de E.A.T. eut lieu le 14 décembre 1966. La raison d’être 4 de E.A.T., signée par le tandem Klüver/Rauschenberg, reprend en des termes plus pragmatiques l’énoncé de mission cité plus haut. Incluse dans une brochure sur E.A.T.. Elle fut remise aux journalistes quelques semaines plus tard, à une conférence de presse annonçant officiellement la fondation de l’organisation. Elle se lisait comme suit :
| " The purpose of Experiments in Art and Technology is to assist and catalyze the inevitable active cooperation of industry, labor, technology and the arts. E.A.T. has assumed the responsibility of developing an effective method for collaboration between artists and engineers with industrial sponsorship.
The collaboration of artist and engineer under industrial sanction emerges as a revolutionary contemporary process. Artists and engineers are becoming aware of their crucial role in changing the human environment and the relevant forces shaping our society. Engineers are aware that the artist’s insight can influence his direction and give human scale to his work, and the artist recognizes richness, variety and human necessity as qualities of the new technology.
The raison d’être of E.A.T. is the possibility of a work which is not the preconception of either the engineer, the artist or industry, but the result of the exploration of the human interaction between these areas. " 5
|
|
" La vocation de Experiments in Art and Technology est de servir de courroie de transmission et de catalyseur pour l'inévitable et active coopération entre les milieux de l'industrie, du travail, de la technologie et des arts. E.A.T. a endossé la responsabilité de bâtir une méthode de collaboration efficiente entre les artistes et les ingénieurs, sous les auspices de l'industrie.
La collaboration entre l'artiste et l'ingénieur, sous l'égide du milieu industriel, est la manifestation contemporaine d'un processus révolutionnaire. Les artistes et les ingénieurs deviennent conscients de leur rôle critique pouvant mener à des transformations de l'environnement humain et des forces décisives formant notre société. L'ingénieur est conscient que l'intuition de l'artiste peut influencer sa voie et donner une dimension humaine à son travail, tandis que l'artiste reconnaît la richesse, la variété et la nécessité humaine, comme des qualités inhérentes à la nouvelle technologie.
La raison d'être de E.A.T. confère la possibilité d'un travail qui n'est ni la préconception de l'ingénieur, de l'artiste ou de l'industrie, mais qui relève plutôt du résultat d'une exploration de l'interaction humaine entre ces domaines. " (traduction libre, Sylvie Lacerte)
|
Les fondateurs de E.A.T. souhaitaient que cette collaboration devienne " organique ", naturelle avec le temps. Inutile de dire que les artistes furent les premiers à s’inscrire et que peu d’ingénieurs joignirent les rangs de cette nouvelle organisation, peu après sa fondation. C’est pourquoi l’on décida de mettre sur pied, en plus du conseil d’administration, un conseil " d’agents " dont le mandat principal serait d’intéresser les milieux industriel et scientifique à la vision de E.A.T. afin de créer des liens durables favorisant la matérialisation de la raison d’être de E.A.T..
Le premier conseil " d’agents " fut constitué de :
Robert O. Anderson, président du Conseil, Atlantic Richfield Corporation;
Alfred H. Barr, premier directeur du Museum of Modern Art New York;
John Cage, compositeur;
Jacob K. Javits, sénateur de l’État de New York;
Philip C. Johnson, architecte;
Gyorgy Kepes, professeur de design, Massachussets Institute of Technology;
Lane Kirkland, assistant exécutif, AFL – CIO;
John R. Pierce, directeur exécutif, Division de la recherche et des sciences des communications, Bell Telephone Laboratories Inc.;
Walter W. Stratley, vice-président Relations publiques, American Telephone and Telegraph Company (AT&T);
Harry Van Arsdale jr., président, Central Labour Council.
Certains membres du conseil des agents se retrouvaient aussi au sein du conseil d’administration de E.A.T., question d’assurer la continuité de sa philosophie.
Les premiers membres à siéger au conseil d’administration de E.A.T. furent les suivants :
Les officiers :
John G. Powers, président du Conseil – avocat et président du Aspen Institute for Humanistic Studies et membre du conseil d’administration du Museum of Contemporary Art, Chicago;
Theodore W. Keel, président du Comité exécutif – avocat et médiateur du travail, président de l’American Foundation on Automation and Employment;
J. Wilhem Klüver, président – ingénieur, Bell Telephone Laboratories;
Robert Rauschenberg, vice-président – artiste;
Fred D. Waldhauer, secrétaire – Technical Supervisor, Bell Telephone Laboratories;
Robert Whitman, trésorier – artiste.
Les administrateurs :
Walter H. Allner, graphiste et directeur artistique, Fortune Magazine;
Richard Bellamy, marchand d’art, directeur/fondateur de la Green Gallery, New York ;
Rubin Gorewitz, comptable agréé, associé à plusieurs compagnies artistiques;
Madame Jacob K. Javits, mécène;
Herman D. Kenin, président, American Federation of Musicians;
Gyorgy Kepes, professeur Visual Design, M.I.T.
Edwin S.Langsam, Film Project Supervision, AT&T;
Paul Lepercq, président, Leperck de Neuflize and Company;
Max V. Mathews, directeur de la recherche comportementale, Bell Tel. Labs.;
Jerald Ordover, avocat, associé à plusieurs organismes artistiques;
Seymour Schweber, président, Schweber Electronics;
Simone Withers Swan, fondatrice de Withers Swan Public Relations, firme spécialisée en art, en architecture et en éducation;
Marie-Christophe Thurman, supporteure des arts et organisatrice de performances.
C’est ainsi qu’au cours des décennies qui suivirent sa fondation, forte de sa raison d’être, sa vision et ses personnalités influentes impliquées au sein de son organisation, E.A.T. entreprit nombre de projets d’envergure et la mise sur pied de services pour ses membres. Les années les plus fertiles de E.A.T. furent sans aucun doute celles qui succédèrent à sa création jusqu’au début des années quatre-vingts. L’intérêt des membres (le nombre atteignit 2000 artistes et presque 2000 ingénieurs) dont certains eurent des carrières et une notoriété internationales, s’amoindrit peu à peu au fil des ans, en même temps que les technologies saisirent le tournant numérique et pour lesquelles d’autres organismes prirent le relais de E.A.T.. Néanmoins, Experiments in Art and Technology est toujours vivant et ses protagonistes actuels, Billy Klüver et Julie Martin, répondent encore aujourd’hui à des demandes de la part d’artistes à la recherche de moyens technologiques pour réaliser leurs projets. Mais, la part la plus grande de l’énergie des Klüver/Martin est présentement déployée à terminer le montage de neuf films sur 9 Evenings, dont deux sont déjà achevés, soit Open Score d’après la performance de Robert Rauschenberg et Kisses Sweeter than Thine d’après la performance de Öyvind Fahlström. 6
Les services aux membres
Les bureaux administratifs de E.A.T. étaient situés au 49 East 68th Street à Manhattan, dans un immeuble appartenant à la American Foundation on Automation and Employment, plus connu sous le nom de Automation House. Le président de cette fondation, Theodore W. Keel siégeait aussi au conseil d’administration de E.A.T. comme président du Comité exécutif. Le quartier général de E.A.T., quant à lui, était situé dans un loft d’environ 1 700 m2 carrés au sixième étage du 9 East 16th Street. C’est à cet endroit qu’avaient lieu, conférences, performances, points de presses et autres rencontres sous l’égide de E.A.T.. C’était, en quelque sorte, le laboratoire de E.A.T..
Les publications maison :
Dès le 15 janvier 1967 le bulletin E.A.T. News fut lancé, dans le but de tenir les membres informés des activités de E.A.T. ainsi que pour favoriser le recrutement de nouveaux membres et de jumelages artistes/ingénieurs. Julie Martin en était l’éditrice en chef et la principale rédactrice. Des articles sur des nouvelles percées technologiques ou artistiques y étaient également contenus et signés par Billy Klüver ainsi que par différents membres de l’organisation. Ce bulletin parut pendant quelques années pour faire place, par la suite, à deux autres publications E.A.T. Information, fournissant des informations sur les activités de E.A.T. pour le membership et E.A.T. Operations, offrant des renseignements d’ordre plus technique. Une autre publication paraissait de manière plus sporadique, E.A.T. Proceedings. Elle contenait des textes de fond comme en fait foi la première édition, datant du 21 avril 1967, avec un texte de Billy Klüver intitulé " Interface : Artist and Engineer ". Puis, E.A.T. eut l’idée de publier un autre genre de newsletter intitulée Techne, empruntant le format d’un journal quotidien, en-tête et photos à l’appui, et contenant également des articles sur des activités ayant lieu hors de New York.
Il est important d’ajouter que Experiments in Art and Technology créa des " chapitres " locaux dans des villes autres que New York. Tous ces chapitres comptaient leurs propres services aux membres ainsi que leurs newsletters pour informer les artistes et les ingénieurs des activités ou de tout autre projet pouvant retenir l’attention de quiconque s’intéressait aux technosciences. Les chapitres locaux les plus actifs étaient situés à Los Angeles (avec sa publication Survey), San Francisco (E.A.T. Bay Area), Tokyo (E.A.T. Tokyo, après Expo 70). E.A.T. comptait une bonne dizaine de chapitres locaux partout à travers les États-Unis dont à Boston, Washington, Denver, Miami et à Cleveland ainsi qu’en Europe soit en France, en Angleterre, aux Pays-Bas et au Canada, à Toronto et à Montréal.
Technical Services Program :
En plus des publications et des newsletters, E.A.T. offrait une kyrielle de services à ses membres inclus dans le cadre du Technical Services Program (1966-1973). Dans ce programme on retrouvait ce que Klüver nommait les bull sessions, ou les Lecture-Demonstration Series (1968-1969). Ces sessions d’information étaient destinées principalement aux artistes et prenaient le plus souvent la forme de conférences livrées par des ingénieurs ou des scientifiques, provenant de divers laboratoires de recherches (Bell Labs, Eastman-Kodak, M.I.T., etc.) sur un sujet pour lequel les artistes avaient préalablement manifesté leur intérêt dans des sondages que E.A.T. leur transmettait. Les thèmes abordés allaient de l’holographie, à l’imagerie et au son généré par ordinateur, en passant par le laser, etc. Ces assemblées étaient fort animées et devenaient rapidement, à la suite des présentations de chacun des spécialistes invités, le site d’échanges fructueux. Pour Klüver ces rencontres représentaient un moyen par excellence pour faciliter les échanges entre deux mondes, jusque là demeurés étanches.
Le service des appariements ou de jumelage (matchings) entre les artistes et les ingénieurs et dont E.A.T. News était la courroie de transmission, par la voie des sondages mis en circulation auprès des membres, permettait à E.A.T. de connaître la nature des projets et d’en jauger les besoins techniques. Après évaluation, il était alors possible pour le personnel de E.A.T. de consulter sa banque d’ingénieurs inscrits (ou de puiser à l’extérieur de la banque) pour amorcer une collaboration entre deux personnes dont les domaines spécifiques étaient pertinents pour les uns et les autres. Après que le partenariat eut été établi, E.A.T. laissait toute son autonomie à la nouvelle équipe et n’intervenait pas dans les étapes de conception et de réalisation des projets. L’idée de départ de Klüver étant de rendre l’artiste souverain dans sa démarche, E.A.T. n’agissant qu’à titre de transducer, ou de médiateur.
Pendant sa première année d’opération (1966-1967) E.A.T. procura aussi un service d’information téléphonique (Technical Information) à ses membres artistes, en plus de leur faire valoir quelles étaient les ressources documentaires disponibles, dans divers centres de documentation, bibliothèques ou librairies de la région de New York, telles les publications scientifiques, techniques et technologiques.
Finalement, au chapitre des services, E.A.T. offrit également un service de location ou de prêt d’équipements pour des projets ou des performances se déroulant à l’intérieur de la région de New York. Une personne en était responsable et avait pour mandat, entre autres, de décrire les pièces d’équipements disponibles dans le E.A.T. News. Les artistes devaient par ailleurs apporter le renfort pour le transport et l’installation de cet équipement.
1 - Énoncé de mission de Experiments in Art and Technology, 10 octobre 1966, gracieuseté de E.A.T. avec la collaboration de la Fondation Daniel Langlois.
2 - Un texte de Billy Klüver sur EAT (2000) figure à la rubrique vouée au fonds documentaire EAT sur le site de la Fondation Daniel Langlois, http://www.fondation-langlois.org/f/projets/eat/index.html.
3 - Il est possible de trouver une biographie de Robert Rauschenberg sur le site du Musée Guggenheim, http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_bio_133.html.
4 - En français dans les documents de EAT.
5 - Raison d'être EAT, 1967
6 - Ces deux bandes vidéo sont contenues dans le fonds documentaire E.A..T. de la Fondation Daniel Langlois.
© Sylvie Lacerte & Leonardo/Olats, juin 2002
Nos rubriques :
|